La page s’est tournée il y a deux ans, soixante-cinq ans après notre première rencontre, c’était en 1953, dans l’effervescence du Barbare, ce lieu mythique d’une génération de Lausannois qui se côtoyaient au bar ou aux tables, selon leurs motivations – vieux jazz, drague, besoin de s’exprimer, engagement politique. Il était alors Jean-Pierre, j’étais Freddy, entre bavardages et projets réalisés, Pierre appartenait à la rédaction de la revue Alambic qui devait faire paraître deux numéros, j’étais dans celle de Pays du Lac, qui vécut neuf numéros grâce à l’obstination de Jacques Chessex. Le « malaise romand » était le maître mot contre l’inconvenance que représentait le fait d’exprimer des sentiments, des idées, des opinions, il motivait nos velléités de rompre les non-dits.
 Dans l’ambiance clanique des débats aussi passionnés que définitifs du Barbare ou lors de verrées entre le Lyrique, le Chat noir et la Bavaria, nos liens d’amitié se sont tissés. Lausanne bouillonne. De nos élucubrations sort un projet de plus, faire paraître, sous forme de journal, un mensuel culturel dans lequel, inconvenance, on introduit la politique. La part « engagée » s’affirme dans le titre choisi : Clarté, référence à la revue créée par Henri Barbusse ; la part du besoin est dite dans l’éditorial du premier numéro : « Partout, il faut montrer patte blanche et jouer le jeu, même si l’on n’en admet pas les règles. »
Dans l’ambiance clanique des débats aussi passionnés que définitifs du Barbare ou lors de verrées entre le Lyrique, le Chat noir et la Bavaria, nos liens d’amitié se sont tissés. Lausanne bouillonne. De nos élucubrations sort un projet de plus, faire paraître, sous forme de journal, un mensuel culturel dans lequel, inconvenance, on introduit la politique. La part « engagée » s’affirme dans le titre choisi : Clarté, référence à la revue créée par Henri Barbusse ; la part du besoin est dite dans l’éditorial du premier numéro : « Partout, il faut montrer patte blanche et jouer le jeu, même si l’on n’en admet pas les règles. »
Ces années sont aussi celles où le théâtre se révolutionne. Avec Jean Vilar et le Théâtre National Populaire, le texte est roi, l’espace épuré, avec Bertolt Brecht et le Berliner Ensemble, l’acteur ne s’identifie pas au personnage, le réalisme n’est pas la réalité. Avec Pierre nous constituons une Association des Amis du TNP, nous invitons pour une conférence Roland Barthes[1] et, des wagons décorés des emblèmes du TNP, nous organisons le déplacement de 400 jeunes et amis en train de Lausanne à Genève pour assister à une représentation de Dom Juan.
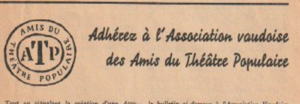
Nous sommes en 1956, pour garder mon passeport suédois, pays d’origine de mon père, je dois partir pour la Suède y effectuer mon service militaire. Je reçus, dans ma caserne, réalisé à l’initiative de Pierre, un quatrième numéro de Clarté. Ce fut le dernier.
À mon retour en Suisse, Pays du Lac avait cessé de paraître, Domaine Suisse lui avait succédé avec une rédaction élargie, dont Pierre faisait partie, et dans laquelle, par amitié malgré mon éloignement, on m’avait maintenu. Domaine Suisse devait également disparaître ; le constat était là : il s’avérait impossible de faire exister un moyen d’expression dans lequel simplement poser nos interrogations. L’immuabilité n’acceptait que le silence.
Dans ce moment, Pierre travaille à la librairie Payot à Genève et perçoit une brèche possible. Des éditeurs français, dont les livres secouent des idées et concepts acquis, n’ont pas de diffuseurs en Suisse. Ce sont les Éditions de Minuit, le nouveau roman et le théâtre de Beckett, les Éditions Pauvert, Sade et le Littré, les Éditions de l’Arche, la revue Théâtre populaire et Brecht ; les diffuser en Suisse permettrait de rompre avec le confinement et d’assurer une continuité.
Encore fallait-il que cela puisse se concrétiser. Si Pierre connaissait le métier de libraire, celui de décorateur, voulu par mon père ne me donnait aucune compétence. C’est avec quelques informations, en totale inconscience, que je me rends à Paris pour y contacter Jérôme Lindon aux Éditions de Minuit, Jean-Jacques Pauvert et Robert Voisin pour les Éditions de l’Arche. Je ne m’explique toujours pas, aujourd’hui, d’avoir obtenu l‘accord des trois éditeurs de mettre en dépôt leurs ouvrages, ouvrages qui leur seraient réglés sur relevés mensuels des ventes. Qu’est-ce qui a pu les convaincre alors que nous n’avions ni raison sociale, ni bureau, ni lieu de dépôt, pas de références, ni argent ? La conviction peut-être, mais aussi une autre époque, où les produits des grandes écoles de marketing n’imposaient pas leur loi et où la teneur du texte imprimé prévalait sur sa valeur marchande.
Conscients ou non, nous créons alors La Cité diffusion, référence au quartier où était situé le Barbare, mais aussi référence à la polis grecque, lieu du théâtre et lieu politique. Les questions d’intendance résolues, un local pour y déposer les livres et de premiers contacts avec les libraires établis, l’enthousiasme fut grand à la réception des livres, ceux que l’on a lus et ceux que l’on découvre, à toucher le papier, à les ouvrir, les classer… Fallait-il ensuite répondre à la confiance accordée. Ni Pierre ni moi n’avions envisagé que La Cité apporte quelque salaire, nous continuons l’un et l’autre nos tâches professionnelles, la motivation était ailleurs.
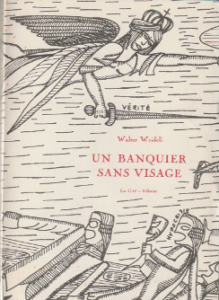 Michel Butor reçoit le prix Renaudot, nous l’invitons pour qu’il donne des conférences. D’autres éditeurs sont contactés, les Éditions d’art Galanis, les Éditeurs Français Réunis ; nous connaissons un refus, Guy Lévis Mano, les tirages des Éditions G.L.M sont trop réduits pour mettre des livres en dépôt. Après quelques mois, Pierre animé par d’autres projets s’éloigne de La Cité, mais le fil de l’amitié ne se distend pas, ainsi, proche de Walter Weideli, il suscite l’édition à La Cité du Banquier sans visage, dont la création suscita une bataille d’Hernani genevoise et fut à l’origine de la fondation du mouvement corporatiste et xénophobe, Vigilance
Michel Butor reçoit le prix Renaudot, nous l’invitons pour qu’il donne des conférences. D’autres éditeurs sont contactés, les Éditions d’art Galanis, les Éditeurs Français Réunis ; nous connaissons un refus, Guy Lévis Mano, les tirages des Éditions G.L.M sont trop réduits pour mettre des livres en dépôt. Après quelques mois, Pierre animé par d’autres projets s’éloigne de La Cité, mais le fil de l’amitié ne se distend pas, ainsi, proche de Walter Weideli, il suscite l’édition à La Cité du Banquier sans visage, dont la création suscita une bataille d’Hernani genevoise et fut à l’origine de la fondation du mouvement corporatiste et xénophobe, Vigilance
En 1962, le binôme fonctionne dans un engagement fort différent, celui des divergences sino-soviétiques : nos cheminements, la décolonisation ou l’affrontement est-ouest, font que les positions du parti communiste chinois soulèvent pour nous des questions importantes que ce soit celle du rôle du tiers-monde comme centre de la contestation dans le monde en se libérant du colonialisme ou qu’il s’agisse de l’absence d’autonomie de penser des partis communistes dans nos pays qui, ballotté entre Spoutnik et Hongrie, sont soumis aux flux et reflux de la politique du parti soviétique. Nous participons avec Pierre à la création du Centre Lénine et participons à faire paraître un nouveau journal, Octobre ; nous militons, organisons des réunions publiques, distribuons des tracts, polémiquons avec le parti du travail, lançons une initiative pour un système de sécurité sociale, « chaulons » des murs avec des slogans pour le Vietnam, payons des amendes pour infraction à la loi. Ce sont les années du débat politique et idéologique qui précèdent la Révolution culturelle en Chine dont il reste à écrire l’Histoire.
Je quitte la Suisse en 1967, l’éloignement distend le lien avec Pierre, mais il ne le rompt pas ; lors de chaque venue d’Albanie avec une autorisation de venir en Suisse y visiter ma mère, je rencontre Pierre. Enseignant, il habite alors Pully ; lors de l’un de nos échanges il me parle de l’exposition Éluard qu’il a organisée, cette exposition lors des préparatifs de laquelle il rencontra Renée, dont la personnalité et la force de caractère ont tant signifié pour lui. Puis, ayant gagné la Suède, ils viendront, avec leur fille Pauline, nous visiter à Uppsala. C’est alors qu’il va publier cette superbe réalisation éditoriale qu’est La Muerte y la Nada, livre illustré de 27 œuvres d’Antonio Saura, avec un texte de Jacques Chessex.

Ma venue à Paris permet à nos rencontres, comme dans les années 1950 et 60, de devenir régulières. Totalement investi dans l’art, il réalise après La Muerte y la Nada, avec le soutien de Renée, d’autres projets éditoriaux, tisse des liens avec nombre de peintres, musées, galeries, journaux d’arts, inspire et insuffle des expositions en Suisse, en Espagne, à Paris. Il le fait pour les peintres qu’il aime, dévoué et généreux, naïf aussi dans un domaine artistique, la peinture, où les enjeux financiers peuvent modifier les plus beaux projets.
Il y eut le décès de Renée, puis la maladie de Pierre qu’il a affrontée, comme Renée, avec un très grand courage. Son dernier projet a été d’organiser à la librairie Payot à Lausanne une rencontre sur Mémoires éclatées, livre dans lequel il est très présent. Au terme de la réunion, fatigué, il est reparti, ce fut, dans une librairie, notre dernière rencontre. Quelques jours plus tard, il était trop tard pour venir de Paris, nous nous sommes quittés, sans le dire, au téléphone.
Fidèle à sa pipe et à son tabac, dont la pochette portait la vignette d’Antonio Saura, discret, mais animé d’intenses passions, calme dans ses gestes, mais impitoyable contre la médiocrité, jusqu’à l’ultime moment, Pierre faisait partager ses sentiments, ses lectures, ses enthousiasmes, ses révoltes. Il fut un ami.
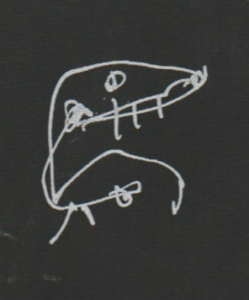
Vignette d’Antonio Saura, emblème de Pierre
[1] Voir sur ce site le blog, Roland Barthes à Lausanne.
