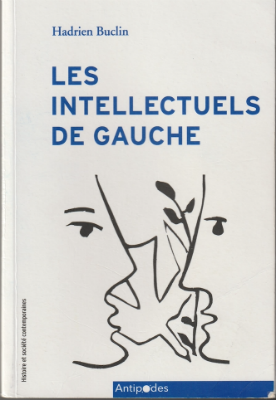Les intellectuels de gauche, une somme de plus de 500 pages dans laquelle Hadrien Buclin rassemble et analyse des informations sur une période, pour moi traversée, allant du sortir de la Seconde Guerre mondiale à 1968[1]. Une lecture qui m’a beaucoup appris et, certaines pages touchant des événements vécus m’ont fait réagir. Sur le conseil d’Eric Burnand, j’ai communiqué ces notes à Hadrien Buclin qui m’a suggéré : « Peut-être serait-il pertinent de publier les commentaires et critiques que vous m’avez envoyés ? Il me semble en effet qu’ils seraient utiles pour la recherche historique et pour de futurs travaux sur le sujet. » Ces notes présentées ici dans leur forme télégraphique, ne sont que quelques gouttes de mémoire apportées à un fleuve de faits, de citations, de références. Ma mémoire ne relate que ce que je sais, dans l’ignorance de tout le reste.
1/ Avant tout s’impose de souligner l’importance du travail de recherche d’Hadrien Buclin, qui fait de Les intellectuels de gauche une somme incontournable sur le sujet et les années concernées.
2/ Une Suisse réactionnaire, j’en étais convaincu, mais jamais je n’ai imaginé que, dans les années 50, la Suisse politicienne restait aussi philofasciste, ni que les dirigeants sociaux-démocrates furent si anticommunistes. Dans le Lausanne du temps des audaces, pour reprendre le titre de Françoise Fornerod, je n’en ai perçu que l’écume.
3/ Un point d’irritation clanique avec Hadrien Buclin, quand le qualificatif de « marxiste » est réservé aux trotskystes. Staliniens, communistes, trotskystes diffèrent et s’opposent par la ligne, le dogmatisme, la trahison, leur histoire, cela ne donne pas droit à une appellation réservée de marxiste aux seuls trotskystes.
Opinion personnelle, au cours du XXe siècle, il n’a pas manqué de marxistes, mais de communistes. Au-delà de la connaissance théorique, il y a le comportement quotidien, la réduction de la part de l’individualisme, cela a plus manqué que la connaissance livresque.
4/ Partant de la thèse de Max Frisch : « L’art pour l’art, l’esthétisme opposé à l’art engagé, voie vers le fascisme », il est établi dans le livre un parallèle avec le rôle du nouveau roman dans les années 1950. Si ce parallèle peut se vérifier ailleurs, l’exemple est fâcheux, l’éditeur du nouveau roman, Jérôme Lindon, fut le premier à dénoncer l’usage de la torture et la nature de la guerre d’Algérie, il fut le seul parmi les éditeurs installés à s’engager contre celle-ci et il fut présent sur nombre d’autres causes et débats, par exemple, puisqu’il en est question dans le livre, en éditant la revue Arguments (p. 197).
5/ J’entends et rejoins la citation de Julia Chamorel sur « la faillite de l’art engagé, le sabordement de la littérature dans le regard glacé du ‘nouveau roman’. » Mais la dédicace reçue en 1960 de son livre Les verts paradis, laisse penser que le contexte des luttes de libération nationale inversait son « défaitisme » et que Julia Chamorel comprenait en quoi, chez Jérôme Lindon, le nouveau roman et La Question étaient indissociables de ses engagements (p. 212).
6/ Sur le procès Bonnard, je regrette que ne soit pas fait mention de sa co-accusée, la belle figure de Fanny Grether (sa « secrétaire »). Son rôle était certes secondaire, mais sa personnalité ne l’était pas. Elle n’a cessé d’être engagée : lors de la guerre d’Espagne, avec la résistance française, contre la répression en Grèce pendant la guerre civile et sous la dictature des colonels, puis avec le FLN (p. 251).
7/ Concernant l’exclusion de Léon Nicole du PST, dont Fanny Grether est restée proche jusqu’à sa mort, il est relevé « la faiblesse culturelle de la gauche autour de Léon Nicole », mais c’est oublié Michel Buenzod, François Jäggi, Robert Dreyfus… courant distinct de Léon Nicole, mais exclu du PST comme courant « intellectuel », quelques mois avant Léon Nicole (p. 260).
8/ Je découvre le projet de Jacques Chessex d’un texte commun de Contacts, Pays du Lac, Clartés et Jeune Poésie contre Marc Chantre. Je n’en ai pas eu connaissance alors : je venais de partir en Suède pour y effectuer mon « école de recrue ». C’est le Chessex combatif et je suis sensible au fait qu’il a joint l’éphémère Clartés à cette initiative (p. 263).
9/ Une belle citation d’André Gorz, plus vraie encore 60 ans après la parution de Le Tricheur: « Ce qui caractérise ce monde… c’est l’inertie monstrueuse de ses structures pétrifiées ; c’est notre impuissance à la changer et l’impossibilité de lui trouver un sens » (p. 265).
10/ Je pense que Marcuse représentait une référence, mais n’était pas la pensée maîtresse pour les animateurs d’Arguments qui étaient, avec Roland Barthes, Kostas Axelos, Edgar Morin, Jean Duvignaud (p. 271).
11/ Très intéressante citation venant d’Yves Velan sur les professions de foi anticommunistes dans le contexte de l’intervention soviétique en Hongrie (p. 301).
12/ La formule de Jean Ziegler : « Genève, un petit Alger au bout du Lac », est belle, mais demande à être précisée. Si à Genève il y avait des soutiens importants aux réseaux Jeanson et Curiel pour les passages de frontières et les hébergements, le centre organisationnel du FLN en Suisse – si l’on excepte le Dr Bentami pour le Croissant rouge algérien -, était à Lausanne. Par le nombre d’Algériens y travaillant et y étudiant, par la présence de leurs représentants, Lausanne fut plus ou aussi « un petit Alger ». Omar Khodja puis Moussa Boudiaf, représentant du FLN en Suisse, comme la direction de l’UGEMA étaient à Lausanne ; c’est à Lausanne que fut signé le communiqué commun entre l’UGEMA et l’UNEF. De nombreux membres de l’UGEMA eurent un rôle important après l’indépendance et le ministère des Affaires étrangères fut un temps baptisé « les Lausannois ». Il y eut également à Lausanne un réseau de solidarité avec les Algériens et les insoumis et déserteurs français, comme, cela doit être rappelé, à Neuchâtel il y eut un réseau de passage de frontière entre la France et la Suisse (p. 305).
13/ Si la position du PCF lors de la guerre d’indépendance algérienne pose les questions que l’on sait, ce ne fut pas simple pour les trotskystes. La IVe Internationale (Frank) a pris position pour le FLN tout en gardant le contact avec le MNA (à l’exemple cité en Suisse du soutien à Merbah), le courant pabliste fut lui clairement pour le FLN et les lambertistes ont fait scission et fondé l’OCI, apportant leur soutien au MNA. Ce qui n’explique évidemment pas la position idéologique et politique de la direction du PCF sur la lutte de libération du peuple algérien, à laquelle des communistes se sont opposés, mais montre que dans leur contexte, les choix ne sont pas toujours évidents (p. 306).
14/ Il est juste de préciser que la position du PST ne fut pas celle du PCF, proche de celle du PCI, elle était beaucoup plus ouverte. Si des réserves existaient envers le FLN au sein du PST, elles tenaient peut-être aux « manières violentes » du FLN (qui rappelons-le menait une guerre), mais dans les échanges que j’ai eus, il était principalement évoqué, réserve plus idéologique : qu’un parti communiste ne peut intégrer une lutte qui n’est pas dirigée par des communistes et dont le parti n’est pas la force dirigeante. Sur cette question, la ligne du PCA, trop méconnue, justifie attention (p. 306).
15/ En Suisse romande, au contraire de la Suisse alémanique, la question FLN/MNA n’a à ma connaissance, jamais interféré dans la question du soutien à la lutte du peuple algérien (p. 315).
16/ Il est surprenant d’apprendre le rôle de Vincent Auriol parmi les initiateurs du PSA. Combien sont-ils en France à le savoir ? (p. 308)
17/ Si j’interprète correctement Hadrien Buclin, j’ai un réel désaccord sur la proposition selon laquelle les tensions entre puissances communistes et capitalistes se seraient déplacées à partir de 1962 vers le tiers-monde. La période de grande intensité révolutionnaire, d’abord principalement en Asie (continent initiateur de Bandoeng), puis en Afrique, va de la fin des années 1940, jusqu’au milieu des années 1960. Le Tiers-monde est alors l’épicentre des luttes, l’Est et l’Ouest s’y confrontent par forces interposées. Les mouvements de libération sont alors ressentis comme une menace par l’impérialisme qui mène, par la guerre et la répression, une contre-révolution dans le tiers-monde. L’année 1965, coup d’État en Indonésie et assassinat de Ben Barka, marquent le tournant annonçant le reflux des luttes anti-impérialistes (sauf pour l’Amérique latine), les limites de Bandoeng et de la Tricontinentale, la victoire du néocolonialisme. Trois victoires révolutionnaires et des peuples, celle du Vietnam sur la plus grande puissance militaire dans le monde, de Cuba, résistant aux difficultés imposées par le blocus des États-Unis et de l’Afrique du Sud qui va se libérer de l’apartheid, vont masquer le fait que la contre-révolution impérialiste a endigué l’impétuosité du mouvement révolutionnaire et que les conditions sont dès lors remplies pour établir la domination néocoloniale et imposer au monde l’idéologie néo-libérale et l’économie de marché. Si 1962 peut être considéré comme le début d’une phase dont le paroxysme sera 1968, c’est comme événement européen et occidental (et également japonais). Y voir une amplification du mouvement révolutionnaire dans le monde me parait une vue occidentalocentriste (p. 319).
18/ À propos des représentations d’Andorra de Max Frisch, la formule texte-programme à l’exemple du TNP de Jean Vilar, comme pour Force de loi de Debluë et Soldats de papier de Jotterand, avait été envisagée avec Charles Apothéloz, mais on n’a pas obtenu les droits. Par contre toutes les pièces jouées par le Théâtre populaire romand (TPR), jusqu’en 1966 sont parues à La Cité comme texte-programme. Il fut aussi dans le moment d’Andorra envisagé que l’Arche (éditeur de Brecht) édite le théâtre de Frisch, je servis d’intermédiaire, mais les conditions de traduction de l’Arche et les exigences éditoriales de Suhrkamp, son éditeur allemand, ne le permirent pas (p. 356-357).
19/ Le Banquier sans visage a été un événement culturel et politique, d’une plus grande importance que le livre n’en fait état. Ce fut un Hernani genevois, comme le relate le remarquable travail de Léonard Burnand sur les événements qui précèdent la création : débats autour du choix de la pièce, quadrillage policier de la première, formation de Vigilance… (p. 370).
20/ Si Bernard Liègme et le TPR sont mentionnés, le rôle intellectuel de Liègme, comme son engagement durant la guerre d’Algérie restent sous-estimés et le nom de Charles Joris, modèle d’obstination pour faire vivre un théâtre populaire, sans qui il n’y aurait pas eu de TPR, oublié (p. 371).
21/ Petite erreur chronologique, on a fondé La Cité diffusion avec Pierre Canova, mais lors de l’édition de La Question et le début de La Cité éditeur, Canova était engagé sur d’autres projets (p. 372).
22/ L’influence de Dellberg et l’importance de cette belle personnalité ne doivent certes pas être sous-estimées, mais l’influence idéologique de ceux qui vont créer la LMR, dont Delaloye et Uldry, est incontestablement plus celle d’Ernest Mandel (p. 375).
23/ Dans la note (p. 381), le ? concerne Jacques Beynac, insoumis français, réfugié à Lausanne, lui aussi influencé par Ernest Mandel.
24/ L’influence de la question algérienne en Suisse romande me paraît plus importante qu’elle n’apparaît dans le livre, si on rappelle la solidarité qui s’est manifestée avec les Algériens et avec les insoumis et déserteurs français, ceux qui se sont engagés dans les réseaux de soutien, la manifestation contre l’intervention de Georges Bidault au Théâtre municipal à Lausanne, la réunion publique où il fut interdit à Claude Bourdet d’intervenir, la réunion de Saint-Cergue à l’origine du Mouvement anticolonialiste français, aux bulletins anticolonialistes et à de nombreuses autres initiatives (p. 381).
25/ Le besoin d’un « second souffle » au MDE la guerre d’Algérie terminée, témoigne précisément de l’importance de la question algérienne et de la vitalité qu’elle a insufflée dans la gauche Suisse romande (p. 385).
26/ Sur les engagements tiers-mondistes, post-indépendance de l’Algérie. S’il y a un romantisme révolutionnaire dans le soutien direct apporté aux Algériens par des intellectuels de gauche, il y a de même un romantisme révolutionnaire à effectuer un service civil dans les pays devenus indépendants, mais les deux ne peuvent être mis sur le même plan. Les risques diffèrent (à l’exemple de Jean Mayerat). Il faut aussi distinguer ceux partis faire un service civil pour apporter leurs connaissances professionnelles apportant ainsi une utile solidarité, de ceux qui partis faire la révolution ailleurs parce qu’il n’y avait pas de révolution chez soi. Cela relevait d’une méconnaissance du caractère et de la nature de la lutte de libération conduite par le FLN et la déception était au bout du chemin (p. 385).
27/ Marc Nerfin est précisément le contre-exemple. Son choix n’a pas été un « passage » tiers-mondiste. Sa proximité en Tunisie avec Ahmed Ben Salah, le soutien qu’il lui a apporté quand il fut condamné (en liaison avec des partis sociaux-démocrates), le rôle qui fut le sien dans la bataille pour un autre développement, étant de ceux qui furent à l’origine du débat onusien sur le « développement durable », démontrent que pour Marc Nerfin ce fut une solidarité et un engagement profonds touchant les problèmes et besoins du tiers-monde. (p. 388).
28/ Au-delà des positions anticommunistes des dirigeants sociaux-démocrates, je reste stupéfait devant celles adoptées lors de la guerre du Vietnam et du pogrom en Indonésie ; jusqu’où peut aller le balancier considérant que l’on est de gauche ? (p. 394-396-399).
29/ Sur la place des immigrés en Suisse, sujet sensible : l’enquête sociologique publiée à La Cité, J’ai quitté l’Espagne, a été à l’origine de plusieurs convocations par la police, notamment pour savoir qui était l’auteur, évidemment jamais révélé. Les conditions d’accueil des étrangers et le « mouvement contre la surpopulation étrangère », premier mouvement xénophobe d’importance en Europe après la Seconde Guerre mondiale, sont justement rapportés dans le livre. On y évoque moins les actions se rapportant à la situation politique dans leur pays d’origine et les initiatives de solidarité avec les luttes antifascistes. L’action du Comité pour l’amnistie des prisonniers politiques en Espagne à l’initiative de Simone Hauert (dont le rôle militant pour le droit des femmes est par ailleurs relevé) est mentionnée. Comité qui a organisé à Lausanne une grande et émouvante réunion avec Julio Alvarez del Vayo, lors de laquelle il lui a été interdit de parler de la République. Encore l’Espagne, à Genève la présence de Jose Herrera Petere. Mais il y eut aussi une aide politique et matérielle aux prisonniers grecs apportée par les sœurs Grether et Bernard Liègme, bien avant 1967, la date indiquée dans le livre, et un comité d’aide aux immigrés portugais anti salazaristes soumis à une forte présence de la PIDE en Suisse. J’ai participé au Comité pour l’amnistie des prisonniers politiques en Espagne, il était à son origine moins « libéral » qu’indiqué dans sa composition, mais l’exécution de Grimau devait sensibiliser l’opinion bien au-delà de la gauche (p. 403).
30/ Concernant la rupture sino-soviétique, de 1963 à 1965, période précédant la révolution culturelle, lors de laquelle a prévalu la désignation de « marxiste-léniniste » pour ceux qui étaient favorables aux thèses du Parti communiste chinois, la Suisse fut – hors l’épisode Bulliard, très bien analysé, par Luc van Dongen -, l’un des premiers pays européens où se regroupèrent des « M.L. ». Le mouvement fut marginal, mais il eut un rôle de propagation dans d’autres pays des textes du PCC, alors boycottées par les partis communistes favorables au PCUS et de soutien à des militants espagnols, portugais et africains, défendant les positions du PCC.
31/ On est surpris que le Tessin, sauf une brève référence, soit ignoré. Le PSA, l’influence chez les jeunes de Gramsci ou de Togliatti, Berlinguer Nenni, celles des intellectuels marxistes italiens dans un moment désigné comme l’âge d’or du marxisme italien, font quel leur cheminement intellectuel et militant y diffère de celui de la Suisse alémanique et romande. Il est vrai que cela aurait complexifié encore un projet déjà immense.
32/ L’absence de maintien dans l’engagement c’est là loi naturelle, génétique : renoncements dus aux aléas de la vie, au fait d’être établi, peurs qui viennent avec l’âge ; une évolution pour les intellectuels favorisée par leur environnement social. Une attitude différente chez les ouvriers dans les années 20/40 est due au fait que, hors leur appartenance au monde ouvrier, ils n’avaient pas d’identité. Lien d’appartenance qui s’est dilué avec les « trente glorieuses », le morcellement de la classe ouvrière, le consumérisme, l’individualisation. S’est ajouté le caractère essentiellement salarial des revendications, réduisant celles-ci, comme l’a si justement formulé Pierre Bourdieu à « j’ai mal au foie, alors, que j’avais mal partout » (p. 420).
33/ L’autonomisation du milieu intellectuel, j’ai le sentiment qu’en Suisse romande cette autonomisation précède les années 1960, imprégné qu’il était par la définition, la connaissant ou non, de Jean Duvignaud de l’intellectuel : « né avec l’affaire Dreyfus, il est celui qui dit non », par le rôle de Sartre, de Merleau-Ponty, d’Henri Lefebvre, pour lesquels l’intellectuel n’est pas le savoir, mais le savoir engagé (un rôle qui va d’ailleurs de Joliot-Curie à Raymond Aron) (p. 423).
34/ Le démarchage de signatures par des jeunes : je peux mentionner, antérieurement aux années 60 deux initiatives, en 1953, un appel de soutien à une manifestation de l’été de l’amitié entre Strasbourg et Amsterdam (manifestation entre les Festivals de la jeunesse organisés par la FMJD) ayant recueilli les signatures d’André Bonnard, Max Frisch, Hans Erni, André-François Marescotti… et en 1960, un appel de soutien à la grève des militants algériens dans les prisons en France, avec les signatures de Karl Barth, Ernest Ansermet, Max Bill, Leopold Ruziscka, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch à nouveau… appel qu’aucun journal suisse ne reprit alors (sauf, il m’a été rapporté, Die Tat) (p. 424).
35/ Le dernier paragraphe est une parfaite conclusion à laquelle j’adhère pleinement : « À l’heure où nombre de citoyens ne perçoivent plus le sens de l’engagement politique, car ils se sentent dépassés par des processus mondialisés sur lesquels ils pensent n’avoir pas prise, ce constat conduit à rejeter tout fatalisme et tout relativisme et à considérer la réflexion, l’organisation et l’activité de chacune et chacun comme le moteur du changement. »
Que d’engagements rappelés ou découverts en lisant Les intellectuels de gauche, notamment sur leur rôle et leur action en Suisse alémanique. Les contacts étaient rares, la frontière linguistique assez étanche pour moi et je fus fortement impressionné par la réunion publique à Zürich lors de mon expulsion, où j’ai découvert une gauche suisse allemande dont la position critique (sur la situation politique en Suisse) était incontestablement plus formulée et structurée qu’elle ne l’était en Suisse romande.
Les intellectuels de gauche, un livre à lire pour connaître ces années et aussi pour comprendre celles d’aujourd’hui.
[1] Editions Antipodes, 2019.